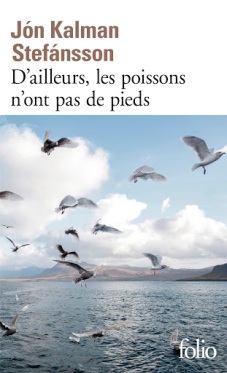
Folio – 2017 – 480 pages
*
Ari est un éditeur exilé au Danemark depuis deux ans, sans que l’on sache vraiment ce qui l’a fait fuir. Etouffant au coeur des montagnes islandaises, il abandonne du jour au lendemain sa femme et ses enfants. Un matin, il reçoit un message de son père mourant et se trouve contraint de revenir à Keflavík, cette terre où « nulle part ailleurs en Islande, les gens ne vivent aussi près de la mort. »
Les souvenirs d’Ari resurgissent en même temps qu’il entame son retour sur son île natale. Son enfance dans les années 70, le spectre de sa mère, dont on ne sait pas grand chose si ce n’est qu’Ari n’a jamais guéri de son absence.
Le récit de Jón Kalman Stefánsson, entre réalité brute et onirisme, nous transporte dans le passé de cet homme un peu torturé mais aussi dans celui de son grand-père Oddur, un marin intrépide, qui tomba fou amoureux de Margrét, à la beauté renversante.
Poésie et mélancolie entament leur lent ballet. Les lieux sont gorgés de souvenirs et d’insolite – à l’image de ce bar appelé Janvier 1976 – et les personnages lisent trop de poésie et veulent habiter sur la lune.
Aucune linéarité, passé et présent s’entremêlent, se superposent. On saute d’un personnage à l’autre – les digressions sont trop nombreuses, au point que parfois je dois relire certaines pages et me retrouve noyée par tant d’histoires superposées… Le narrateur s’éparpille trop ; d’ailleurs qui est-il ? est-ce un fantôme, un souvenir, une âme du passé ? Ou un double d’Ari, son ombre plutôt ?
J’ai eu beau être agacée par ces digressions incroyables, ce roman demeure magnifique avec de nombreux passages que j’ai eu envie de recopier… Stefánsson a une façon tellement unique de parler de l’amour, de la beauté et de la folie humaine… Sous sa plume, l’Islande et ses fjords, ses montagnes et ses glaciers se déploient, prennent vie. On a l’impression d’y être.
« Ce qui nous empêche de nous désagréger, de tomber en morceaux, de nous transformer en malheur, en plaie suintante ou en pure cruauté, c’est la poésie, la musique : l’art. À la fois excuse et justification de notre existence, à la fois provocation, accusation et cri, en dépit des paradoxes irréconciliables qui habitent chaque être humain, l’art est ce qui nous permet de vivre sans sombrer dans la folie, sans exploser, sans nous transformer en blessure, en malheur, en fusil. Il est ce qui permet malgré tout à l’homme de se pardonner les imperfections de sa condition humaine. »


